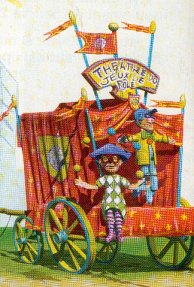 Définition
psychologique du jeu en général : "Avec le language,
le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :
travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles
qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."
Définition
psychologique du jeu en général : "Avec le language,
le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :
travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles
qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."
Définition du jeu de rôles
(JdR) : Les joueurs, généralement 3 ou plus, interprètent
des personnages en vivant une aventure (le scénario) proposé
par le meneur de jeu, qui prépare la trame de l'histoire, puis anime
et arbitre la partie qui dure en général entre 4 et 6 heures.
L'aventure comporte des énigmes et des obstacles que les personnages
doivent franchir. Il n'y a ni gagnant, ni perdant, le but étant pour
les joueurs de coopérer pour mener à bien l'aventure. Joué
autour d'une table, c'est un jeu de dialogue : le meneur de jeu décrit
une scène (décors, personnages non-joueurs, actions en cours...),
chaque joueur indique ce que fait ou tente de faire son personnage, le meneur
de jeu indique le résultat et la suite de l'aventure, et ainsi de suite.
Les règles du jeu fournissent un cadre : des données chiffrées
(les caractéristiques) permettent au joueur de choisir les capacités
de son personnage, qui servent au cours du jeu à vérifier, par
un jet de dés, si chaque action hasardeuse tenté par le personnage
réussie ou échoue.
+ voir document : "instantané
d'une partie"
b) Le
jeu de rôles dans le monde
La répartition géographique
du JdR dans le monde est rès limitée. En effet, un haut niveau
culturel et éducatif est nécessaire à la compréhension
de son fonctionnement, mais également financier, car la distibution
d'un jeu nécesite des traductions hardues, et un marché restreint
limite la rentabilité pour les éditeurs, d'où une diffusion
qui ne dépasse que très rarement la frontière des boutiques
spécialisées.
Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant de retrouver les Etats-Unis en tête de la production
et de la consommation de ce type de loisir. Avec 1 million de pratiquants
et des jeux qui se retrouvent en tête des ventes dans tous les autres
pays consommateurs, le pays d'origine des JdR (avec Dongeons & Dragons,
le premier et le plus vendu) ne connait pas de (grosse) crise des recettes
comme en France.
Notre pays se retrouve donc en
deuxième position, avec pas moins de 400 000 amateurs. Ce succès
s'explique par l'image qu'à la France aux USA : un pays au fort patrimoine
artistique et culturel, les éditeurs américains n'ésitent
donc pas à vendre leurs produits ici. Mais également, un facteur
explicatif est que la production nationale est très importante, ce
qui a pour conséquence de saturer le marché, mais aussi de voir
certains de jeu repris et traduis par les américains. A noter que les
fanzines, les associations et les jeux amateurs se retrouvent dans une quantité
qui ne retrouve nul part ailleurs sur le globe.
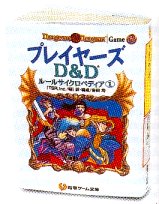 En
Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains
et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent
peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",
la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat
d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un
développement commercial plus florissant mais moins créatif
qu'en France.
En
Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains
et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent
peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",
la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat
d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un
développement commercial plus florissant mais moins créatif
qu'en France.
Le Japon se retouve ici où
là. Pour eux, les rares jeux traduits sont systématiquement
"manganisés", et les quelques jeux crées sont
des produits dérivés de manga et rencontrent un succès
suffisant malgré le manque de diversité. Enfin l'Angleterre,
qui ne possède pas, elle, la barrière des langues avec les Etats-Unis,
se contentent d'acheter leurs produits et d'écrir quelques suppléments
pour ces derniers, une sorte de "pied-à-terre" en
quelque sorte.
c) Les
divers types de jeu de rôles
1. Les jeux de rôles
"classiques"
C'est le jeu de rôle tel
que nous l'avons décrit : 4 à 8 joueurs autour d'une table
avec feuilles de personnages, livres de règles et scénario,
une pôignée de dés bizzares à 4, 6, 8, 10, 12
ou 20 faces, du matériel pour écrir et ... c'est tout !
2. Les jeux de rôles
sur Internet
Avec l'arrivée de ce nouveau
média, les rôlistes ont trouvés un terrain de jeu et
moyen d'expression des plus vastes : il n'y a qu'à voir le nombre
complêtement délirant de sites consacrés aux JdR (j'ai
moi-même bien du en voir quelques centaines !), rien qu'en français,
il y en a quelques milliers, présentant pour la plupart des productions
personnelles pour des jeux existants ou de leur cru, des communautés
de nature diverses (regroupés par associations, ville, jeu, ou encore
spontanément), des projets en cour, etc... La communauté rôliste
est décidement, sur Internet, une des plus importante et des plus
active. Mais passons maintenant aux diverses formes de jeu de rôles
sur Internet.
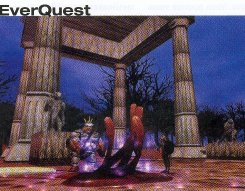 Il
y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle
des "jeux de rôles online", qui se présente
comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"
très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé
son personnage, lui achète un équipement et part à
l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,
peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D
ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de
moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60
à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication...
Il
y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle
des "jeux de rôles online", qui se présente
comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"
très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé
son personnage, lui achète un équipement et part à
l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,
peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D
ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de
moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60
à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication...
Ensuite on trouve les MUDs
(pour Multi-Users Dongeon), des JdR multijoueurs, qui au contraîre
des jeux on-line sont entièrement textuels : chaque endroit, personnage,
objet, événement est décris par un texte s'affichant
à l'écran. Les commandes sont rentrées au clavier (ex
: take sword, eat food, go north, etc...), sont traités par
le serveur et le résultat est affiché à l'écran
par un nouveau texte. On y accompli des quètes, on s'y bat contre
les autres joueurs connectés, on y gère ses affaires, et le
monde continue à tourner en votre absence. S'il faut faire un effort
indéniable pour apprendre les commandes de bases, les MUDs apportent
des expériences bien plus proches du JdR classique. Et sur n'importe
quel type de configuration, le tout gratuitement dans la plupart des cas.
Le dernier type de JdR sur Internet
et le moins difficile d'accès reste le PBeM ("Play by e-mail",
jouer par e-mail), principalement car ce n'est qu'une adaptation pur
et simple du JdR papier, les différents protagonistes dialoguant
par courrier électronique ou par Chatroom.
3. Le jeu de rôle
"Grandeur Nature"
 Apparu
en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le
"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré
du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre
d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de
"théâtre ludique interactif". Un GN dure en
général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants
variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.
Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,
des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.
Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine
désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,
chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.
L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels
se déroule les scénarios en font une aventure vécue
par les participants, destinée à des spectateurs.
Apparu
en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le
"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré
du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre
d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de
"théâtre ludique interactif". Un GN dure en
général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants
variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.
Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,
des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.
Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine
désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,
chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.
L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels
se déroule les scénarios en font une aventure vécue
par les participants, destinée à des spectateurs.
Les combats et les affrontements existent - encore que cela dépende
du jeu - mais sont avant tout régentés par un ensemble de
rêgles visant à assurer une sécurité maximale.
A titre d'exemple, les armes blanches seront des épées en
mousse ou en latex, et les armes à feu des pistolets tirant des projectiles
en caoutchouc. Il n'y a donc pas plus d'inquiétudes à avoir
de ce côté-là que pour n'importe quel autre événement
sportif.
II-
La place du jeu de rôles dans la société
a) La
mauvaise image du jeu de rôles
"Pour le grand public,
les jeux de rôle pourraient se reduire aux activités de jeunes gens
dépravés se réunissant au sein de sectes, pour accomplir, des nuits durant,
des rites sataniques". A travers cetter phrase, le lieutenant
de gendarmerie Matelly résume l'image du jeu de rôles pour la plupart
de la société...
Associé, à tort, à des agressions,
à des suicides, ou à des profanations, le potentiel criminogène du jeu de
rôles reste à prouver, car il faut le rappeler, mais le jeu de rôles
présenté ici est un jeu de société, et non un moyen d' investigation psychanalytique.
Or, l'intensité criminogène du jeu de rôles est faible, comparé à la
télévision...
Largement décrié par les médias,
le jeu de rôles l'est car il est méconnu, autant du grand publique,
justement, des médias. Ainsi lors des profanations de tombes juives à Crapentras,
L' EXPRESS titrait : "Ils ( les jeu de rôles) s'inspirent
de satanisme, de légendes médiévales, mais aussi d'un fatras idéologique où
s'entremèlent croix celtiques et délires nasillons. Bref, un culte de l' horreur
susceptible de déraper à tout moment." Mais la presse télévisée a elle
aussi "menée" son enquète sur cette affaire, dans l' émission "Bas
les masques", par exemple, présentant rapidement certains jeux de
rôles, comme par hazard les plus extrèmes. De plus, elle ne donne jamais
la parole à des spécialistes, qui porteraient un regard plus objectif sur
ce loisir. Mais le plus inquiétant est l'acharnement des médias vis à vis
du jeu de rôles. A propos de l'affaire de Carpentras, on a parlé de
"jeu de la sorcière", ou "scénario de la sorcière" sur de grands
journaux. Mais il faudrait peut-être que des recherches un peut plus
approfondies aient été effectués par les journalistes, puisque ce jeu est
totalement inconnu des des spécialistes des jeux de role. Enfin, autre facteur
de confusion, le jeu de rôles est souvent assimilé aux "Livres dont
vous etes le héros" et autres jeux vidéos, ce qui est tout à fait faux...
Comment, dès lors, donner crédit
aux accusations portées par la presse, vu le déficit d'informations, selon
lesquelles le jeu de rôles conduirait au crime et serait néfaste ?

Jeune, drogué, sataniste, suicidaire,
égoiste, violent, manipulateur, en marge de la société. Voici à peut près
le portrait du rôliste pour tout un chacun, sauf pour les rôlistes. Pour eux
(et pour nous), c' est plus un être humain, jeune ou vieux (mais plutôt jeune),
romantique dans l' âme, débordant d' imagination et, avec un groupe d'amis,
qui à part leur atrait pour ce loisir, n'ont pas grand chose en commun. Mais
ceci mis à part, ils ne sont pas plus dangereux que des moutons...
On parle souvent de délits ou de
crimes liés au jeux de rôle (affaire de Carpentras). Mais le jeu de
rôles, en tant que loisir, nécessite un degré d'instruction relativement élevé
et occupe ces temps de loisirs dans un cadre collectif .Or, l'ennui, l'oisiveté
et les loisirs passifs sont dénoncés comme criminogènes, alors que le jeu
de rôles propose quant à lui un loisir actif. Il allie activité, sociabilité
et esprit d'équipe. Le rôliste a besoin d'une imagination élevée, et de capacité
à se projeter dans le futur, le présent et le passée, ainsi que dans l'abstrait.
Il est donc le contraire du présentiste, pour qui il est impossible de se
projeter dans l'avenir, à "la recherche du plaisir immédiat et sans contraintes
: l'acte crimminel,sans se soucier des normes ou de la morale". En outre
de son caractère contraire au présentisme, le jeu de rôles, par son principe
de projection dans des univers imaginaires ou réels, tout en alliant activité,
sociabilité et esprit d'équipe, peut favoriser les rapports à la norme et
la morale.
III-
Rapports historiques
a) Naissance
du jeu de rôles
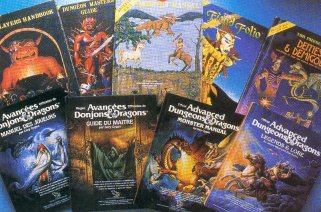 Le
jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien
que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive
sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera
gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,
le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,
jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de
la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,
et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.
Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la
foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres
de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune
étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant
à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions
comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.
Le
jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien
que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive
sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera
gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,
le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,
jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de
la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,
et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.
Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la
foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres
de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune
étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant
à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions
comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.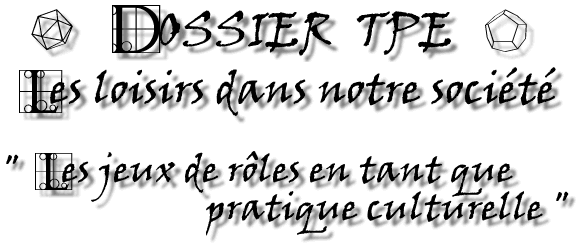
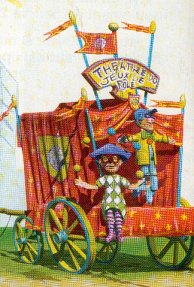 Définition
psychologique du jeu en général : "Avec le language,
le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :
travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles
qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."
Définition
psychologique du jeu en général : "Avec le language,
le jeu constitue la voie d'accès aux activités culturelles :
travail, art, idéologie, politique, comme aux relations interpersonnelles
qui les sous-entendent : amour, jalousie, haine, découverte d'autrui..."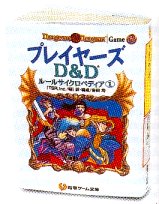 En
Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains
et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent
peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",
la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat
d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un
développement commercial plus florissant mais moins créatif
qu'en France.
En
Allemagne la tendace est plutot inverse : ils traduisent les jeux américains
et produisent eux-mêmes des suppléments pour ces jeux, mais créent
peux de nouveaux jeux. C'est aussi là-bas que la "Spiel Tage",
la plus grande manifestations rôliste d'Europe se produit, résultat
d'une bonne acceptation de ce loisir par la société, et d'un
développement commercial plus florissant mais moins créatif
qu'en France.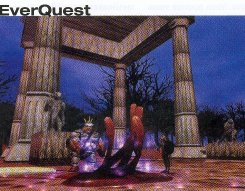 Il
y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle
des "jeux de rôles online", qui se présente
comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"
très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé
son personnage, lui achète un équipement et part à
l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,
peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D
ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de
moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60
à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication...
Il
y en a trois, et celle qui est certainement la plus jouée est celle
des "jeux de rôles online", qui se présente
comme un jeu vidéo avec un univers "persistant"
très fortement inspiré des JdR papiers : le joueur créé
son personnage, lui achète un équipement et part à
l'aventure, rencontre d'autres personnages dirigés par d'autres joueurs,
peut même ouvrir son commerce, tout ça dans un univers en 2D
ou 3D au graphisme élaboré. Mais cette débauche de
moyens a un prix : environ 300 FF pour le jeu, plus un abonnement de 60
à 100 FF par mois, et tout ça sans compter les coups de communication... Apparu
en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le
"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré
du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre
d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de
"théâtre ludique interactif". Un GN dure en
général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants
variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.
Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,
des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.
Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine
désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,
chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.
L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels
se déroule les scénarios en font une aventure vécue
par les participants, destinée à des spectateurs.
Apparu
en France en 1983 (où il regroupe aujourd'hui 20 000 amateurs), le
"grandeur nature" (GN) est à la fois inspiré
du JdR sur table que des murder-parties anglaises ou encore du théâtre
d'inprovisation; d'ailleurs, certains spécialistes le qualifie de
"théâtre ludique interactif". Un GN dure en
général de 4 heures à 2 jours avec un nombre de participants
variant de 10 à 300, avec un nombre non-négligeable d'organisateurs.
Les joueurs interagissent ici en costume et en direct, menant des enquêtes,
des négociations ou des actions tout en interpretant leur rôle.
Le GN se déroule soit en huit-clos (maison, château, usine
désafectée... ), soit en extérieur (rue, forêt,
chantier... ), en fonction de thèmes souvent proche du cinéma.
L'interactivité, l'improvisation et les vastes espaces dans lequels
se déroule les scénarios en font une aventure vécue
par les participants, destinée à des spectateurs.
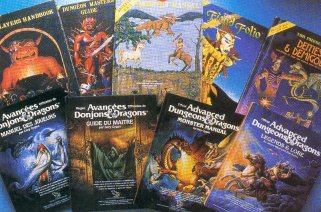 Le
jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien
que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive
sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera
gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,
le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,
jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de
la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,
et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.
Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la
foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres
de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune
étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant
à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions
comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.
Le
jeu de rôles a 30 ans. Mais son histoire est longue et semée d'embûches. Bien
que crée en 1971 par deux américains amateurs de littérature fantaisie, il arrive
sur le marché en 1974. Son public est d'abord très restreint, mais son nom restera
gravé dans les mémoires : DONGEONS & DRAGONS (D&D). Entre 1975 et 1980,
le jeu de rôles explose et sa popoularité croit de jour en jour. AD&D,
jeu de fantaisie médiéval, se rajoute des dizaines d' autres jeux, allant de
la mythologie à l'odysée de l'espace. Mais au fur et à mesure, D&D s'allourdit,
et voulant profiter de son statut de leader, mène une guerre aux autres jeux.
Ses créateurs, profitant de leur monopôle dans le secteur, ont créé dans la
foulée une maison d'édition spécialisée dans les jeux de rôles et les livres
de fantaisie. Pourtant, des ennuis assaillent la société, TSR, en 1979. Un jeune
étudiant disparaît, et le détective chargé de le retrouvé pense que l'étudiant
à des problèmes à se socialiser, et qu'il se réfugie dans des obsessions
comprenant la drogue, l'homosexualité, et bien sur D&D.